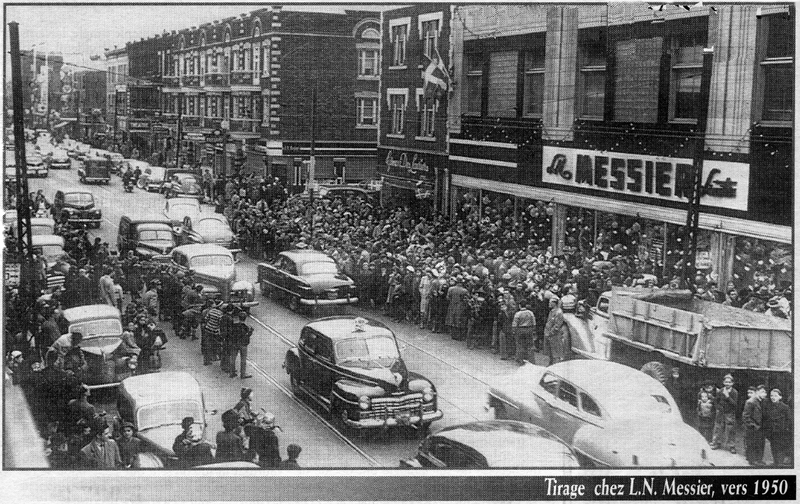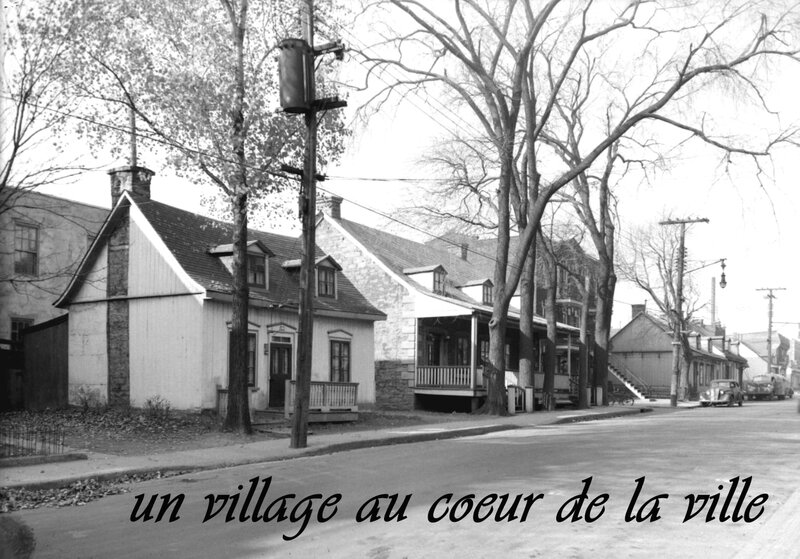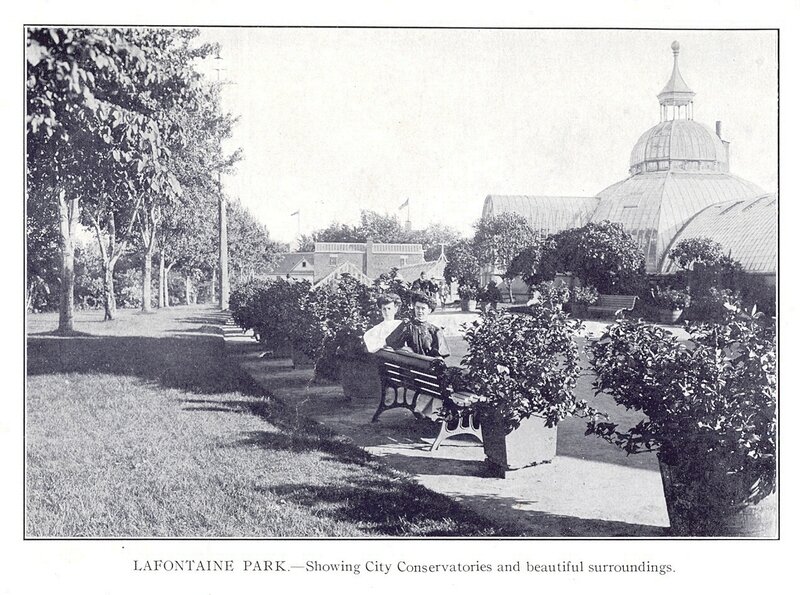Quand j’étais petit, j’ai déjàété le petit garçon le plus riche du monde ! J’avais même mon propre coffre-fort !
En fait, mon père m’avait offert une petite tirelire en métal, prêtée par la Banque d’Épargne de la Cité et du District de Montréal. Pour moi, elle semblait très solide et surtout, très sûre ; avec ses véritables clefs et sa lourde porte. On ne parle pas ici d’un vulgaire cochon rose en plâtre ; qui doit être finalement sacrifié pour obtenir le fruit de nos économies ; Non, Non ! Un véritable coffre-fort, avec une clef qui permet des retraits et une gestion avisée de notre gros 6.75$ ; bien sûr avec l’aide du parent détenteur de la fameuse clef.
![DSCN6922]()
En fait, voici la véritable pièce de collection (photo d'Ange Pasquini)
![coffre-fort 2]()
J’avais malgré tout l’impression d’être vraiment riche. Parfois, mon grand-père me donnait en cadeau, un grand cinquante sous rond ; une roue de «gros chars» comme il disait. Alors là, c’était le comble du ravissement, d’entendre le bruit sourd de la pièce qui tombe dans la tirelire. C’était probablement ce genre de plaisir, qu’entretenait le Séraphin des «Belles Histoires». Mais, pour un enfant de cinq ans ; c’est quand même pas très inquiétant !
Ces souvenirs me ramènent plus de soixante ans en arrière et bien que la banque s’appelle maintenant «la Banque Laurentienne», c’est toujours la même institution ; la succursale est toujours au même endroit et elle a fait récemment les frais d’une rénovation en profondeur. Pour moi, c’était même le troisième décor de cette succursale que je voyais. Ce n’est pas banal. Comme je conserve toutes sortes de choses (et que mes parents faisaient de même avant moi) j’ai retrouvé dans mes vieilles boîtes pleins d’articles reliés à cette banque. Cela m’a donné l’idée de leur proposer que notre société d’histoire organise dans la succursale, une petite vitrine-exposition afin de marquer l’inauguration de leurs nouveaux locaux. J’avais différents artefacts illustrant les opérations de cette banque (carnets bancaires, chèques anciens, cartes de guichet, etc.) et je pensais intéressant que notre société montre ça aux gens du quartier.
Il faut dire que cette succursale bancaire est la plus ancienne de l’avenue du Mont-Royal ; même si elle est maintenant la plus moderne ! Elle existe au même endroit depuis plus d’une centaine d’années. L’histoire de l’institution elle-même n’est pas banale non plus puisque que c’est à l’instigation de Monseigneur Bourget lui-même, que différents hommes d’affaires montréalais, dont plusieurs notables du quartier, ont mis sur pied cette institution de la Banque d’Épargne de la Cité et du District de Montréal ; qui visait prioritairement à promouvoir l’épargne chez les francophones montréalais. Outre de grands noms comme Louis-Joseph Papineau, Louis-Hippolyte Lafontaine ou Georges-Étienne Cartier ; on retrouvait parmi les fondateurs ou directeurs ; les noms de Boyer, Comte, Fabre et même le docteur Pierre Beaubien de Saint-Louis du Mile-End.
La Banque Laurentienne ayant préféré décliner notre offre (nous aurions quand même bien aimé entendre tomber quelques «roues de gros chars» dans notre maigre budget ; mais ce sera pour une autre occasion), nous pensions qu’il serait malgré tout intéressant de verser les photos et quelques explications à notre site internet ; pour le bénéfice de ceux qui aiment se rappeler de vieux souvenirs.
Voici donc quelques éléments de cette petite collection.
![DSCN6905]()
Tout d’abord, les vieux carnets du grand-père ; ainsi qu’un chèque datant de 1920 ; versé sur l’hypothèque de la maison qu’il avait achetée quelques années plus tôt, rue Christophe-Colomb.
![DSCN6917]()
Des chèques rédigés dans la langue de Shakespeare
![DSCN6898]()
Des livrets presque "Flower Power"
![DSCN6907a]()
À cette époque, la banque est une institution importante et le «gérant de banque», un homme encore plus important. À cette époque, les banques ne courent pas après les clients pour leur prêter de l’argent ; c’est plutôt le contraire ! Le gérant à droit de vie ou de mort sur l’emprunt ; d’où l’importance de son statut.
Les opérations bancaires étaient également fort différentes d’aujourd’hui. Toutes les opérations s’effectuaient en personne et toutes les transactions étaient inscrites manuellement, à la plume, par le caissier, dans le carnet de l’épargnant et dans le «grand ledger» de la banque. Par la suite, des «machines» sont venues prendre charge des écritures.
![DSCN6914]()
Plusieurs années plus tard, l’arrivée de l’électronique et de l’internet est venue transformer le monde bancaire et les façons, pour les clients, de faire affaires avec la banque. L’apparition des caissiers automatiques a par la suite facilité l’accès à l’argent à toutes heures du jour et a finalement transformé les clients en «caissiers virtuels». Les reçus de guichet et les relevés électroniques ont depuis remplacés les livrets.
![DSCN6887]()
Ces livrets ont aussi revêtus de nombreux habillages au fil du temps. Bien sûr, pendant un long moment, la banque s’est appelée la «Montreal City and District Savings Bank» ; mais elle fut surtout connue sous le nom de «Banque d’Épargne», avant de devenir la Banque Laurentienne.
![DSCN6912]()
C’est assez intéressant de penser qu’un emplacement commercial de l’avenue du Mont-Royal puisse demeurer aussi longtemps au même endroit et continuer d’exister malgré autant de changements dans son fonctionnement et dans son environnement d’affaires. Entre Monseigneur Bourget et aujourd’hui, il en est passé des «trente sous» dans les caisses de cette banque.
En passant ; j’ai toujours ma petite tirelire et je la trouve toujours «impressionnante»